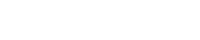Chapitre Un : Retrouver Notre Chemin
Extrait de Réorienter une nation : Comment le corps de Christ peut promouvoir efficacement le changement au Canada. Droits d’auteur 2024 Craig Docksteader | Tous droits réservés
Quand la plupart des chrétiens pensent à créer du changement dans une nation, ils pensent au changement politique. Ils imaginent élire un autre gouvernement, un nouveau premier ministre ou un autre député. Mais ça n’a pas toujours été ainsi. À une époque, l’attitude générale au sein de l’Église était que les chrétiens n’avaient pas à s’impliquer en politique ou dans d’autres rôles dans l’espace public. Pour le monde, la seule mission de l’Église était l’évangélisation et le discipulat. Sauver les perdus et les amener à l’Église.
Certaines personnes sont allées encore plus loin, convaincues que tenter de changer la société était essentiellement charnel (pour ne pas dire désespéré) et que le mieux qu’on puisse faire, c’était de sauver des âmes et de les mettre à l’abri dans l’Église, parce que tout allait de toute façon empirer. Il n’y avait pratiquement aucune vision pour avoir un impact sur la société. Notre rôle se résumait à nous retrancher, sauver le plus de gens possible et attendre le retour de Jésus.
C’était peut-être parce que, à l’époque, les chrétiens se souciaient peu de la façon dont le pays était gouverné. Personne ne menaçait de leur retirer leur liberté religieuse, et la nation était encore largement façonnée par des valeurs judéo-chrétiennes, donc il y avait peu de raison de s’en mêler. D’autres s’en occupaient et tout semblait aller rondement. Pour beaucoup de chrétiens, le ministère se trouvait uniquement dans l’Église, et l’idée même qu’on puisse être appelé à servir dans l’espace public n’existait pas.
Mais à un moment donné, cette attitude a commencé à changer.
Aux États-Unis, la célèbre déclaration de William F. Buckley—« Je préfère être gouverné par les deux mille premières personnes dans l’annuaire téléphonique de Boston que par les deux mille professeurs de l’Université Harvard »—annonçait déjà ce changement de mentalité. Ce point de vue n’était pas anti-intellectuel, mais reposait plutôt sur la conviction que la sagesse et les opinions de la personne ordinaire devaient être reflétées dans les politiques publiques et les décisions politiques.
Au cours des trente années suivantes, des années 1960 aux années 1980, l’idée que la politique devait être laissée aux élites a été continuellement remise en question par la montée du mouvement des droits civiques, la contre-culture hippie, les manifestations contre la guerre, l’activisme étudiant et les voix anti-establishment.
Dans les années 1980, la première ministre britannique Margaret Thatcher et le président américain Ronald Reagan ont été élus sur des plateformes populistes, ce qui a contribué à populariser encore davantage cette vision. Leur style de leadership terre-à-terre et accessible rejoignait le gros bon sens des citoyens ordinaires. C’est également à cette époque qu’a émergé aux États-Unis le mouvement de la « Majorité morale » de Jerry Falwell. Ce mouvement encourageait les chrétiens et les gens ordinaires attachés aux « valeurs traditionnelles » à s’exprimer sur les questions politiques et à se lever pour défendre leurs convictions. Les efforts de Falwell étaient controversés, car ils allaient à l’encontre de la compréhension populaire chez les chrétiens américains selon laquelle il devait y avoir une séparation stricte entre la religion et la politique, mais ils ont marqué un éveil des chrétiens à leur responsabilité de s’informer et de s’impliquer dans l’espace public. La « droite religieuse » commençait à faire sentir sa présence.
Comme souvent, le Canada a pris du retard. Peut-être était-ce notre déférence naturelle envers l’autorité ou notre tendance à nous excuser simplement d’avoir une opinion différente, mais cette même mobilisation citoyenne n’a vraiment commencé à se manifester chez nous que vers la fin des années 1980.
De nombreux facteurs contribuent aux changements sociaux, mais si on se demande ce qui a commencé à éveiller les chrétiens au Canada à l’importance de s’engager dans l’espace public, un catalyseur indéniable a été la montée du Parti réformiste. Celui-ci a été créé en grande partie en réponse au sentiment d’aliénation de l’Ouest, mais avec le temps, il s’est transformé en un mouvement qui prônait une approche populiste et participative du leadership politique et a fini par acquérir un attrait national.
Les gens en avaient assez de l’élitisme des partis fédéraux de tous les horizons et du manque de connexion entre les politiciens et les valeurs ou le gros bon sens des citoyens. Le Parti réformiste a commencé à attirer des candidats politiques qui n’étaient pas des professionnels de la politique, mais des gens ordinaires désireux de promouvoir un changement constructif et d’influencer la direction du pays. Cela incluait une forte augmentation du nombre de chrétiens rejoignant le parti et se présentant comme candidats aux élections fédérales. Ce n’était pas un effort coordonné ou organisé : c’était un réveil, une prise de conscience chez les chrétiens qu’ils avaient la responsabilité sociale de participer aux décisions politiques qui façonnent la société. Il y avait une conscience grandissante que Dieu appelle son peuple à influencer la société plutôt qu’à s’en retirer, et l’approche populaire du Parti réformiste offrait une occasion et un véhicule pour le faire.
Mais c’était plus que cela. Dans Preston Manning, l’Église voyait un chrétien passionné par sa vision d’un Canada meilleur et qui utilisait l’espace public pour promouvoir des politiques concrètes. Après Manning sont venus Stockwell Day, puis Stephen Harper, tous deux également assumés dans leur foi chrétienne. Beaucoup de chrétiens ont alors commencé à se voir une place dans l’espace public. Au fur et à mesure que des pans de l’Église canadienne ont adopté cette nouvelle vision—celle que leur implication pouvait faire une différence—un sentiment d’élan et d’optimisme a commencé à naître.
Entre 2000 et 2015, on sentait une anticipation palpable que les chrétiens étaient sur la bonne voie et qu’ils étaient sur le point de voir des changements majeurs dans le pays. Des organisations chrétiennes se sont formées pour mobiliser, outiller, soutenir et encourager les croyants à s’engager dans la vie publique. La prière pour la nation et pour le gouvernement est devenue un axe central qui a pris racine et prospéré. Des conférences, des rassemblements et des réunions de prière régulières se sont tenus sur la colline parlementaire et ailleurs, mettant en lumière le besoin de changer la direction du pays. Des efforts ont été faits pour repérer et soutenir des candidats chrétiens et les aider à se faire élire. Ceux qui ne pouvaient pas se présenter étaient encouragés à s’impliquer dans les campagnes, à donner de leur temps et à soutenir financièrement. Tout cela était nécessaire et bienvenu. C’était un changement rafraîchissant et stimulant après des décennies d’apathie où les chrétiens avaient pratiquement déserté l’espace public. Mais ce n’était pas suffisant.
Je me rappelle encore de la profonde déception en 2015 lorsque Stephen Harper n’a pas été réélu premier ministre. Même si bien des chrétiens ne se voyaient pas comme strictement partisans, ils trouvaient que les valeurs du Parti conservateur s’alignaient davantage avec les leurs. Par conséquent, beaucoup se sont mobilisés pour appuyer la campagne conservatrice par la prière et leur engagement. Quand les conservateurs ont perdu, de nombreux chrétiens qui avaient travaillé si fort et cru si profondément ont été dévastés et désillusionnés.
Au lieu de s’améliorer, les choses se sont détériorées. Le nouveau gouvernement libéral a commencé à détricoter plusieurs des avancées réalisées sous Stephen Harper et a introduit des politiques qui, pour beaucoup de chrétiens, étaient troublantes : la légalisation du cannabis, l’aide médicale à mourir, l’effacement du lien entre sexe anatomique et identité de genre, le financement renouvelé de l’avortement à l’étranger, la fermeture du Bureau de la liberté de religion—les changements étaient alarmants.
Après avoir surmonté leur déception, beaucoup de chrétiens ont décidé de redoubler d’efforts. Ils ont cru qu’il suffisait de faire encore plus : plus de prière, plus d’activisme, plus d’engagement, plus de sacrifice. Ils ont aussi élevé la rhétorique : à les entendre, si le Parti libéral n’était pas défait, le pays serait ruiné et n’atteindrait jamais son destin en Dieu. De la même façon que Dietrich Bonhoeffer s’était levé contre l’Allemagne nazie, les chrétiens devaient résister au gouvernement libéral par la prière, les proclamations et l’action politique.
Il y avait une conviction grandissante que l’élection fédérale de 2019 devait être—et serait—un point tournant. Mais cela ne s’est pas produit. Le Canada a élu un gouvernement libéral minoritaire appuyé par un trio de partis encore plus à gauche. Pas exactement la recette d’une réforme. Lorsque les résultats électoraux de 2021 ont été pratiquement identiques à ceux de 2019, l’ambiance s’est assombrie encore plus. Malgré toute la prière, les efforts et le temps investis, rien n’a abouti. Encore et encore et encore.
———–
Procurez-vous votre exemplaire de Réorienter une nation ici : https://fr.toshiftanation.ca/produit/acheter-reorienter-une-nation/